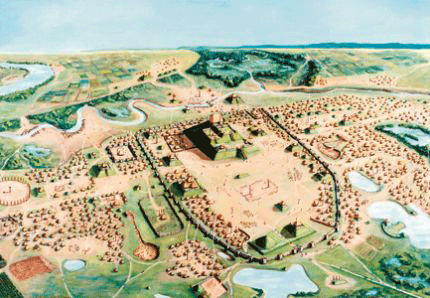
Depuis l’arrivée des premiers Européens en Amérique du Nord, qui eurent la surprise de s’apercevoir que d’autres peuples y vivaient déjà, la question du passé des autochtones s’est posée, question à la fois complexe et épineuse sur le plan politique.
Des années durant, la vie des Indiens d’Amérique a été considérée à travers les prismes mêlés du racisme et du romantisme, ce qui permettait d’idéaliser les sociétés indiennes d’avant la colonisation tout en justifiant leur destruction. On pouvait imaginer cette réalité précolombienne comme une ère de ténèbres sauvage et brutale ou comme un éden respectueux de l’écologie, où l’homme vivait en parfaite harmonie avec la nature.
Mais ce monde semblait exister en dehors de l’Histoire, comme si les peuples de ce continent avaient été immunisés, pour une raison quelconque, contre la cupidité, la cruauté, la guerre et autres traits presque universels de la société humaine.
Comme l’explique clairement le fascinant nouveau livre de l’archéologue Timothy Pauketat, Cahokia: Ancient America’s Great City on the Mississippi (Cahokia, une grande ville de l’Amérique antique sur le Mississippi), Cahokia, la plus grande ville amérindienne au nord de Mexico, appartient bel et bien à l’histoire humaine. (Elle n’est cependant pas “historique” au sens étroit du terme, car les Cahokiens n’ont laissé aucune trace écrite.)
A son apogée, au XIIe siècle, ce centre urbain implanté dans les plaines alluviales du Mississippi, dans l’ouest de l’Illinois, à quelques kilomètres à l’est de la moderne Saint Louis, était probablement plus grand que le Londres de l’époque.
Son influence économique, culturelle et religieuse s’étendait sur une grande partie du centre des Etats-Unis. Il était doté d’une place centrale de 25 hectares et abritait la troisième plus grande pyramide du Nouveau Monde (ou “colline des Moines”, de plus de 30 mètres de haut). Cahokia comptait au moins 20 000 habitants.
Cela peut paraître insignifiant du point de vue du XXIe siècle, mais il faudra attendre près de six cents ans pour qu’une autre ville, Philadelphie, atteigne la même taille sur le territoire des Etats-Unis.
Il ne reste qu’environ 80 des quelque 120 tumulus et/ou temples du site. Quant aux cités vassales sises là où se trouvent aujourd’hui Saint Louis et East Saint Louis, et qui comportaient toutes deux de grandes pyramides centrales, elles ont été complètement rasées par les colons aux XIXe et XXe siècles.
Cahokia a fait l’objet de fouilles rapides et brouillonnes, avant que ne se ruent les bulldozers des promoteurs impatients d’y dresser des motels ou d’y tracer des autoroutes.
Dans les années 1940, un lotissement de banlieue fut construit au beau milieu du site, qui couvre près de 8 900 hectares.
Dans les années 1960 encore, un propriétaire se creusa une piscine sur la place cérémonielle de la cité antique. (Le lotissement et la piscine ont depuis été détruits.)
Et même, voilà à peine une génération de cela, beaucoup d’archéologues et d’anthropologues auraient trouvé l’expression “ville indigène” (Native American city) curieuse et contradictoire.
La vision universitaire du passé n’était finalement pas si éloignée que cela de l’idée que s’en faisait la culture populaire : les Indiens d’Amérique vivaient sans surexploiter la terre, organisés en sociétés de chasseurs-cueilleurs que complétait une agriculture de subsistance.
Peut-être avaient-ils des “centres cérémoniels”, ainsi que des villages saisonniers et des camps de pêche et de chasse, mais ils n’habitaient pas sur des sites permanents, et encore moins de grandes dimensions. Aux yeux de Pauketat, ce canon universitaire est la version aseptisée, politiquement correcte, des préjugés durables à l’encontre des capacités des Amérindiens.
Car si Cahokia est de loin le plus grand de ces sites, ce n’est certainement pas le premier. Dans le Grand Sud, on trouve plusieurs complexes à tertres antérieurs à l’ère chrétienne. En Louisiane, l’un d’entre eux a été daté de 3400 av. J.-C., longtemps avant l’érection des pyramides égyptiennes ou mayas.
Bien que les premiers explorateurs, comme Hernando de Soto, aient personnellement rencontré des tribus urbanisées au XVIe siècle, la plupart des sites avaient été abandonnés quand les colons arrivèrent (sans doute parce que leurs microbes avaient précédé les Européens eux-mêmes).
Par ailleurs, Cahokia a été bâtie il y a plus de neuf siècles avec les matériaux disponibles dans la vallée du Mississippi : la terre, le bois, le chaume. Puis elle a été abandonnée aux éléments, à la décomposition et à l’érosion pendant quatre siècles ans avant que les Américains ne commencent à prendre conscience de son existence.
Une fois qu’elles furent retrouvées, il fut impossible d’ignorer les monumentales cités de pierre des Aztèques ou des Mayas, alors que Cahokia, pour des yeux modernes, n’était qu’un assortiment certes étrange, mais somme toute peu impressionnant, de hauteurs, de coteaux et de crêtes envahis par la végétation.
Un assemblage d’anomalies géologiques
Pour être honnête, il faut signaler que le juriste Henry Brackenridge, qui passa à Cahokia en 1811, la décrivit comme un “monument d’une stupéfiante antiquité”, autrefois le site d’“une ville fort peuplée”.
Il avait compris qu’elle était sans aucun doute d’origine indienne. (Cahokia est un nom qui vient de la tribu des Illinis, qui occupaient la région à l’époque historique.
Personne ne sait comment les Cahokiens eux-mêmes appelaient leur ville.) Les réflexions de Brackenridge tombèrent dans un oubli si complet qu’un siècle plus tard bien des universitaires, qui avaient tiré un trait sur toute une série de délires parlant de bâtisseurs grecs ou hébreux de l’Antiquité, affirmaient désormais que Cahokia n’était qu’un assemblage d’anomalies géologiques et n’avait donc jamais été édifiée par l’homme.
Cette théorie vola en éclats en 1921, quand l’archéologue Warren King Moorehead creusa une tranchée sur le site dit de Rattlesnake Mound, où il mit au jour d’énormes entassements d’ossements humains.
A la suite d’une succession de découvertes sinistres, réalisées à partir de la fin des années 1950, plus aucun doute n’est possible : à l’apogée de Cahokia – qui commença par un “big bang” inexpliqué quand, vers 1050, un village plus modeste fut soudain rasé pour être remplacé par une ville beaucoup grande qui se développa encore pendant cent cinquante ans –, la caste dirigeante pratiquait les “meurtres rituels et les enterrements cérémoniels”.
En 1967-1970, quand Melvin Fowler, Al Meyer et Jerome Rose entreprirent de fouiller le tertre 72, site d’un ancien édifice au sommet d’une crête tout ce qu’il y avait de plus banal, une surprise spectaculaire les attendait, comme l’archéologie en offre rarement.
Une société violente, elaborée, structurée
Le tertre abritait la sépulture de deux hommes de haut rang, presque identiques. L’un d’entre eux était enveloppé dans une cape ou un manteau orné de perles en forme d’oiseau-tonnerre, antique symbole mystique des Amérindiens.
Entourant cette “sépulture à perles”, les archéologues mirent peu à peu au jour d’autres cadavres, mélange, semblait-il, d’enterrements honorifiques et de sacrifices humains, le tout manifestement lié aux deux personnalités enfouies là. En tout, le tertre 72 contenait les restes de plus de 250 personnes.
Pour Pauketat, ce tertre 72 et d’autres fouilles effectuées à Cahokia mènent à une conclusion incontournable : ils sont la preuve d’une société indienne urbaine “caractérisée par l’inégalité, les luttes de pouvoir et la complexité des relations sociales”.
Ces gens n’étaient ni des sauvages à demi animaux, ni de paisibles villageois dans un éden écologique : ils avaient vécu et étaient morts dans une société violente, élaborée, qui disposait de sa propre vision bien définie de l’univers.
Mais c’est en se livrant à une nouvelle analyse de fouilles obscures menées dans les années 1960 par Charles Bareis que Pauketat réalise un coup de maître.
A l’époque, Bareis avait retrouvé un formidable gisement de déchets cahokiens vieux de 900 ans, enterré si profondément que son contenu dégageait encore une puanteur abominable.
Etudiant les strates de matières putrescentes, Pauketat conclut que les terrifiants “rituels mortuaires” de Cahokia avaient peut-être un côté positif. Selon lui, il s’agissait sans doute de cérémonies publiques destinées à honorer la famille régnante ou à introniser un nouveau souverain.
Le gisement de déchets contient les restes de gigantesques festivités, dont près de 3 900 cervidés, 7 900 poteries et d’énormes quantités de citrouilles, de maïs, de bouillie, de noix et de baies.
Il y avait là assez de nourriture pour alimenter toute la population et assez de ce vigoureux tabac local – un million de graines calcinées à la fois – pour que toute la ville en ait le tournis grâce à sa nicotine quasi hallucinogène.
On ne peut évidemment pas savoir avec certitude si ces fiestas qui devaient durer plusieurs jours dans toute la ville avaient lieu en même temps que les sacrifices humains, mais c’est tout à fait plausible, et ils faisaient en tout cas assurément partie du même système social. (Dans le gisement de déchets, Pauketat a également retrouvé des traces de ce qu’il décrit comme “une pompe et un apparat spectaculaires”.)
Pour la cité, ces rituels permettaient de consolider le sentiment d’appartenance à une communauté, un sentiment où religion et Etat fusionnaient, et les Cahokiens “toléraient les excès de leurs dirigeants” – comme nous le faisons presque tous – tant que durait la fête.
Source : www.courrierinternational.com




