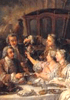Épices, aromates et condiments.
par Jean-Louis Flandrin
Extrait de l’histoire de l’alimentation
Jean-Louis Flandrin et Massimo Montanari
– Editions Fayard
– Parution : Février 2005
– Dimensions : 16 x 24
– Format : 915 pages
– Poids : 1.500 g
 Traditionnellement, le mot « épices » désignait non pas n’importe quel aromate utilisé en cuisine, mais seulement des produits exotiques, venus de loin. Parmi ces produits, pour la plupart importés d’Orient, beaucoup n’avaient pas de fonction culinaire mais seulement une fonction thérapeutique.
Traditionnellement, le mot « épices » désignait non pas n’importe quel aromate utilisé en cuisine, mais seulement des produits exotiques, venus de loin. Parmi ces produits, pour la plupart importés d’Orient, beaucoup n’avaient pas de fonction culinaire mais seulement une fonction thérapeutique.
Quant à ceux dont se servaient les cuisiniers, eux aussi avaient tous des usages médicaux. Le poivre, par exemple, qui selon Le Thresor de santé « entretient la santé, conforte l’estomac […], guérit les frissons des fièvres intermittentes, guérit aussi les morsures
des serpents, fait sortir l’enfant mort» du ventre de sa mère. « Etant bu, [il] sert à la toux […],
mâché avec raisins sec, [il] purge le cerveau du flegme, [et] ouvre l’appétit ».
Le clou de girofle, pour sa part, « sert aux yeux, au foie, au cœur, et à l’estomac. Son huile est excellente contre le
mal des dents. […] Il sert au flux de ventre de cause froide, et aux maladies froides de l’estomac
[…]. Deux ou trois gouttes en bouillon de chapon guérissent la colique. Il aide fort à la digestion,
si on le fait bouillir en bon vin avec semence de fenouil ».
Chaque épice était censée avoir des vertus analogues. Or cette fonction médicale, plus
caractéristique des épices que l’utilisation condimentaire, a aussi été première, historiquement,
puisque chacune des épices employées en cuisine à la fin du Moyen Age a dans un premier
temps été importé comme médicament, avant de l’être pour l’assaisonnement des aliments.
Il reste à établir si ces produits pharmaceutiques, lorsqu’ils étaient utilisés en cuisine au Moyen
Age et à la Renaissance, l’étaient encore pour des raisons médicales ou s’ils ne l’étaient
désormais plus qu’à des fins purement gustatives. Au XIVe siècle, Magninus de Milan mettait en
garde le lecteur de son De saporibus contre l’abus des sauces en raison même de leur nature
médicamenteuse : « Les sauces […] ont une nature médicinale et, par conséquent, ceux qui
savent les refusent complètement dans le régime de santé, car pour conserver la santé on doit
s’abstenir de toutes choses médicinales ».
Pourtant, du XIIIe siècle au début du XVIIe, les médecins n’ont pas cessé de recommander les
épices dans l’assaisonnement des viandes pour rendre celles-ci plus digestes. Dans son
Régime du corps (1256), Aldebrandin de Sienne écrit que la cannelle a le mérite « de conforter
la vertu du foie, et de l’estomac » et de « bien cuire la viande ».
On a vu que tout le monde, à cette époque, se représentait la digestion comme une cuisson.
L’agent essentiel en était la chaleur animale qui cuisait doucement la nourriture dans l’estomac, marmite naturelle. Dans cette optique, les épices dont on assaisonnait les aliments,
contrebalançant l’éventuelle froideur de ceux-ci, aidait aussi à les cuire, car toutes étaient
réputées chaudes, et pour la plupart sèches. Du poivre, on disait qu’il était au quatrième degré
de chaleur et au quatrième aussi de sécheresse; le clou de girofle, le galanga, la cardamome, le
curcuma l’étaient de part et d’autre au troisième ; la cannelle, le cumin, le cubèbe, la noix
muscade au second; etc.
En vérité, nombre d’aromates et condiments indigènes étaient également réputés chauds et
secs : l’ail et la moutarde l’étaient au quatrième degré, comme le poivre; le persil, la sauge, le
pouliot, le poireau, le cresson de jardin et l’hysope de montagne au troisième; le fenouil, le carvi, le cerfeuil, la menthe, la roquette, le cresson de rivière au second, etc. Voyez Le Régime du
corps d’Aldebrandin. D’une manière générale, toute plante aromatique était nécessairement
chaude. Mais les épices, nées sous les climats tropicaux, passaient depuis l’Antiquité pour plus
élaborées, plus subtiles et médicalement plus sûres que les aromates indigènes7.
Il faudrait aussi noter les vertus médicinales du sel, du sucre, des graisses et des acides comme
vinaigres, verjus, jus de citron et d’orange amère, etc. Du sel, chaud et très sec, Le Magninus de
Milan, dans son Régime de santé expliquait qu’il « ajoute aux comestibles la bonté de la saveur,
et il enlève la malice provenant […] d’une certaine humidité acqueuse et indigeste. Et ainsi ils
sont cuits et digérés plus parfaitement avec sel que sans sel ». Et il notait que les aliments
humides et excrémenteux, et avec cela grossiers, comme le porc ont beaucoup plus besoin de
sel que les chairs délicates comme celles des poulets ou des perdrix.
Egalement utiles à la digestion étaient les graisses. Le même auteur écrivait que « Le sel et
l’eau ne suffisent pas : nous avons besoin d’huile, de beurre ou de graisse. Parce que les
légumes et autres plantes potagères sont de nature mélancolique et terrestre, il est en effet bon
de les assaisonner avec quelque chose de gras, qui tempère leur terrestréité, et de quoi leur
saveur est rendue plus délectable et plus suave, et par conséquent meilleur à digérer et à
nourrir ».
Quant aux condiments froids, comme tous les acides, ils n’étaient pas non plus dépourvus de
fonction diététique. Magninus de Milan, dans le De Saporibus, prescrivait « que la matière des
sauces, en été, soit le verjus, ou le jus tiré des sommités de la vigne, ou le vinaigre, ou le jus de
citron, ou d’orange [amère], ou de grenade ». Et ces condiment intervenaient, en toutes
saisons, dans beaucoup de sauces pour modérer, par leur froideur, la chaleur des épices. On
en attendait d’eux aussi qu’il transportent les bienfaits des épices dans tous les recoins de
l’organisme, grâce à leur vertu « apéritive », c’est à dire à la pointe acérée de leur molécule (si
l’on nous permet ce concept anachronique) qui leur permettait de pénétrer aisément dans les plus infimes conduits de nos corps.
Au-delà du troisième degré de chaleur comme de froideur, les aliments et condiments étaient
d’ailleurs réputés dangereux. Au quatrième degré de froideur, on trouvait les champignons
vénéneux; au quatrième degré de chaleur, l’ail était censé ne convenir qu’à l’estomac grossier
des paysans; et la plus forte des épices, le poivre, a disparu des livres de cuisine aristocratiques
français des XIVe et XVe siècles, ne restant utilisé qu’à un niveau social inférieur. Pour les
personnes délicates des élites sociales, les cuisiniers français n’usaient que du poivre long –
chaud au troisième degré seulement – et ils l’édulcoraient toujours en le mélangeant à d’autres
épices, moins brûlantes.
D’autre part, ces chaudes épices, utiles aux mangeurs bien portants pour faciliter la digestion de
leurs aliments, auraient été tout à fait déplacées dans le régime des fébricitants, car elles
auraient augmenté leur fièvre. Aussi trouve-t-on dans la plupart des livres de cuisine médiévaux,
un chapitre de recettes « Pour malades » qui sont complètement dépourvues d’épices. Si l’on ne
s’abstenait pas de cuisiner leurs aliments, tous étaient bouillis, aucun rôtis ; et au lieu d’épices,
les deux tiers de ces mets étaient assaisonnés de sucre, le plus tempéré des condiments,
réputé même légèrement rafraîchissant et dont on faisait grand usage en pharmacie.
– Flandrin, Jean-Louis. Histoire de l’alimentation occidentale
– Découvrez le livre « Histoire de l’Alimentation »