samedi 26 juillet 2008
Par Ursula Gauthier, envoyée spéciale du NouvelObs
Patrouilles incessantes, contrôles d’identité à chaque instant, mouchards, caméras de surveillance, micros-espions dans les rues : quatre mois après la révolte du Tibet, le pouvoir chinois fait régner à Lhassa, d’où les journalistes sont bannis, une paranoïa qui rappelle les pires persécutions staliniennes…
A Lhassa, les chauffeurs de taxi sont presque tous chinois, les cyclopousses presque tous tibétains : c’est un des signes les plus visibles de l’inégalité des statuts qui fait grincer les dents des Tibétains. Mais depuis l’écrasement de la révolte du 14 mars et l’imposition d’une loi martiale qui ne dit pas son nom, on n’entend plus la moindre plainte. Il faut être fou, ou inconscient, pour élever la voix. Ou ivre. C’est le cas de ce jeune homme qui prend un taxi un jour de juin, trois mois après les émeutes. Il vient d’une « bonne famille tibétaine », il est éméché et sans doute arrogant. Sûrement trop confiant dans l’entregent de son père, haut cadre du Parti. Il se répand en invectives contre ces Chinois qui se conduisent au Tibet comme en pays conquis. En temps normal, le chauffeur aurait fait profil bas, de crainte que le fils à papa ne le prive de sa licence. Mais les temps ont changé. Le petit taxi sichuanais s’arrête au premier carrefour et va se plaindre auprès des soldats postés là comme à tous les coins de rue. Les militaires foncent sur l’ivrogne. Malgré sa mise de golden boy de la nomenklatura, malgré le nom de son père qu’il hurle en chinois, ils le jettent sur le pavé et s’acharnent sur lui à coups de botte – jusqu’à ce que mort s’ensuive. Paralysée d’effroi, une foule immense a suivi toute la scène, sans un mot, sans un geste. Mission accomplie. Tout Tibétain, du haut en bas de l’échelle, sait désormais qu’il risque la mort au moindre soupçon d’irrespect à l’égard de la puissance chinoise. Lhassa doit oublier la dangereuse audace des grappes de jeunes qui hurlaient d’excitation en arrachant les grilles métalliques de la Banque de Chine, qui caillassaient les camions militaires, incendiaient les commerces chinois et molestaient leurs boutiquiers. Après avoir passé en boucle à la télévision les images inouïes de ces jours de désordre et de rébellion, le pouvoir veut maintenant imprimer la terreur dans les esprits.
La présence militaire est écrasante, les contrôles d’identité incessants. Ne pas avoir ses papiers entraîne une arrestation immédiate, parfois une disparition définitive. Car la lutte contre les « éléments criminels » responsables des troubles de mars n’est pas terminée. Une liste d’émeutiers recherchés est toujours affichée sur des panneaux publics. Les contrôles visent surtout les grands gaillards aux cheveux longs, au teint cuivré, portant un rosaire au poignet, une turquoise au cou ou une dent en or : des Tibétains des hauts plateaux, qui ont fourni le gros des insurgés de mars. « La plupart sont renvoyés dans leurs bleds, souffle un habitant de Lhassa sous couvert d’anonymat. Ceux qui ont trempé de près ou de loin dans les émeutes sont arrêtés, torturés, déportés. Une amie chinoise, qui prenait le train quelques semaines après les événements, a vu des centaines d’hommes blessés, claudiquant, couverts de bandages sales, menottes, embarqués sur le train pour Xining. De là, ils auraient été envoyés au Sinkiang, où se trouvent les pires goulags de Chine. Les familles, des nomades ou des paysans illettrés, n’osent pas demander des comptes… »
Cette chasse au faciès a vidé les rues de Lhassa des impressionnants nomades couverts de bijoux qui faisaient tourner les moulins à prières. Surtout fuir toute ressemblance avec ces fiers Khampas qui ont osé se dresser contre les maîtres chinois. Exit la mode « ethnique » qui avait cours chez les jeunes branchés de Lhassa. « Plus personne ne porte les cheveux sur l’épaule : trop dangereux, explique un musicien avec un rire amer. On s’est tous rabattus sur la coiffure déstructurée qui a cours chez les modeux Chinois… » En priant pour ne pas s’attirer la suspicion des uniformes omniprésents.
On ne peut faire trois pas sans tomber, à chaque carrefour, devant chaque bâtiment officiel, chaque point sensible ou symbolique (stations d’essence, postes, banques, etc.), sur des groupes de soldats, l’air mauvais, déployés en éventail, fusils pointés vers l’extérieur, doigt sur la gâchette. Dans toutes les rues et ruelles, toutes les cinq minutes, une patrouille de militaires, visages fermés, tenue léopard et gants blancs, défile au pas. Des camions vert-de-gris sillonnent les avenues, exhibant leur cargaison de wujing (police armée) en attirail complet – casques, boucliers, matraques, fusils… Les nombreuses casernes qui entourent la ville sont-elles insuffisantes à loger cet afflux de troupes ? Les unités militaires venues du Sichuan avec leurs véhicules briqués, leur matériel dernier cri, occupent ostensiblement le Musée du Tibet, la Bibliothèque du Tibet, désormais fermés aux visiteurs.
A cette mise en scène qui vise à frapper les esprits s’ajoute la part immergée de l’iceberg : des milliers de mouchards, déguisés en citoyens ordinaires, en nomades, voire en moines, épient les conversations dans tous les lieux publics. « On ne dit plus rien de personnel, sauf aux amis très sûrs, dans des endroits très sûrs, avoue un Tibétain à mi-voix. Prenez la place du Jokhang, le temple principal : c’est le lieu le plus fliqué de la planète. » En effet, il suffit de lever le nez : à côté des caméras de surveillance classiques, les bâtiments qui bordent l’esplanade du majestueux coeur de Lhassa ont reçu de nouvelles caméras sphériques plantées au bout de longs bras horizontaux. Ce sont des fish eyes, capables de filmer à 360°. Le bruit court que des « micros-zooms » ont été installés, qui peuvent capter une conversation particulière à des dizaines de mètres de distance.
De quoi créer une paranoïa qui rappelle l’époque des pires persécutions staliniennes. Les gens simples sont ainsi persuadés que les Chinois disposent de moyens techniques fabuleux. « Quand les fouilles des maisons ont commencé, ma nounou m’a confié en pleurant qu’elle avait détruit les deux photos du dalaïlama qu’elle possédait, raconte une intellectuelle . Pourquoi ne pas les avoir cachées ? Parce qu’elle avait entendu dire que les Chinois avaient une torche spéciale qui bipait et détectait les photos du dalaï-lama les mieux dissimulées… »
Cette terreur extrême, frôlant l’irrationnel, explique peut-être en partie l’absence de photos de la répression. Certes, lors des fouilles, des contrôles, les forces de l’ordre ont spécifiquement recherché les images, épluchant les ordinateurs, les cartes à mémoire des mobiles, saisissant tout ce qui avait trait aux événements de mars. Mais il faut aussi compter avec l’autocensure : « Si quelqu’un a eu le courage défaire des photos des tués, il lui en faut encore plus maintenant pour ne pas les détruire. Quant à essayer de les faire sortir, ce serait de l’héroïsme », affirme-t-on sous le manteau. Toute personne en possession de la moindre image « sensible » est traitée comme un criminel.
Tous les touristes, y compris les touristes chinois, doivent respecter la consigne : pas de photos qui fâchent. Les agences habilitées à recevoir des visiteurs étrangers se sont engagées auprès du Bureau du Tourisme à surveiller étroitement leurs clients : « Pas de photos de militaires, ni de policiers. Pas de photos de bâtiments détruits pendant les émeutes. Ne faites pas de photos d’un quelconque incident, un quelconque heurt entre la population et les forces de l’ordre, insistent les guides. S’il vous plaît, respectez les ordres, nous sommes responsables de votre conduite. »
A ce jour, la stratégie est payante : aucune image n’a transpiré des tueries de mars, ni des arrestations massives qui ont suivi. Quant à celles de l’occupation militaire actuelle, elles se réduisent à quelques photos volées. Le 25 juin, la Chine a pourtant annoncé la réouverture du Tibet au tourisme. En fait, seuls de rares voyageurs indépendants sont admis. Quant aux journalistes accrédités, théoriquement bienvenus, on les empêche systématiquement de s’y rendre. Le Tibet est la seule province de Chine dont l’accès soit subordonné à un permis spécial – aux conditions désormais draconiennes : séjour limité à six jours ; visites et trajets prédéfinis ; guide, chauffeur et même véhicule désignés à l’avance et impossibles à modifier… Ici, les touristes sont surveillés comme le lait sur le feu.
« Jusqu’aux JO, il ne faut pas espérer autre chose que cette ouverture en trompe-l’oeil, estime le patron d’un café privé. Une concession à l’opinion publique internationale, aussi factice que la prétendue reprise du dialogue avec les émissaires du dalaï-lama. » La Chine, à l’évidence, cherche à gagner du temps au Tibet. Mais dans quel but ? Que va-t-elle faire après les JO ? Remédier enfin aux causes réelles de la colère tibétaine ? Ou, comme le redoutent les habitants traumatisés de Lhassa, déclencher « la répression finale » une fois l’attention du monde détournée ?
– Ursula Gauthier
– pour Le Nouvel Observateur

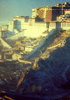



Commentaires sont fermés