Risquer la liberté
Fabrice Midal
Editions Seuil
– En librairie dès le 12 février 2009
Risquer la liberté
interview avec Fabrice Midal
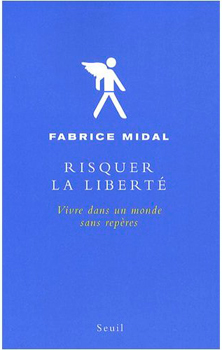
Parce que nous sommes bombardés de discours. Toute la journée, nous entendons des discours, qu’ils soient sociologiques, philosophiques, psychologiques ou économiques, qui visent à tout nous expliquer. Mais à force, l’essentiel finit par faire défaut. Nous n’avons pas besoin de nouveaux discours, mais d’une parole qui s’adresse enfin à nous. Une parole qui réponde enfin pour de vrai à nos questions : Comment être un peu plus humain et que l’inattendu puisse survenir ? Comment pouvoir répondre à l’amour, au manque d’amour, à sa douleur, à son intensité rayonnante ? Comment faire pour que notre vie ne soit pas une accumulation de jours fatigués, mais s’ouvre comme un chemin où quelque chose a à s’accomplir ?
Ces questions qui exigent que nous nous interrogions nous-mêmes, à neuf, n’ont plus de place. La multiplication des discours vient davantage d’une volonté farouche de sécurité que du désir sincère de connaissance. J’ai écrit Risquer la liberté comme un dialogue entre la philosophie, la poésie et l’aspiration spirituelle. J’essaie de montrer à quel moment, en leur sein, il arrive qu’une parole se risque à sortir du discours, se risque à ne pas se répéter.
Nietzsche par exemple, que j’interroge dans ce livre, ne tente pas d’avancer un discours de plus, de parler en expert de quoi que ce soit, ou même, comme on le dit grossièrement, de faire système. Philosophe, il tente d’entrer dans le péril ouvert de notre temps. Il cherche à voir par où nous sommes empêchés de vivre. Si le taux de suicide augmente et devient une des causes premières de mortalité chez les moins de quarante ans dans les pays occidentaux, si le taux de dépression est si important, ce n’est peut-être pas tant à cause de problèmes psychologiques que pourraient avoir certaines personnes, qu’en raison de la manière dont notre monde est en train de tourner au vinaigre. Nietzsche est le premier à remarquer le phénomène qu’il nomme « nihilisme ». Il prend le risque de perdre le connu pour aller dans l’inconnu qui s’ouvre à nous. Or, une pensée qui ne risque rien, ne pense plus, mais devient précisément du discours. Un discours qui nous rassure, qui nous divertit, mais qui n’ouvre aucune brèche par où mieux exister.
Rilke, le deuxième grand témoin que j’interroge dans ce livre, fait un mouvement de grande proximité avec celui de Nietzsche — mais au sein de la poésie. Pour lui la poésie ne consiste pas à écrire des beaux sonnets, à jouer avec les mots, une activité privilégiée d’homme de lettre, mais est le mouvement qui se risque, de la manière la plus entière, dans l’inconnu. Il est entré dans l’inconnu et l’a traversé – il en a d’ailleurs payé le prix.
Lorsque la première guerre mondiale éclate, par exemple, Rilke est en train d’écrire l’œuvre de sa vie Les Elégies de Duino. Cette œuvre trouve une façon de dire « oui » à notre monde, malgré tout, malgré la souffrance, malgré la trahison, malgré la lâcheté. Comment peut-on dire « oui » à l’existence ? La guerre brise son élan. Pendant de nombreuses années, il fait l’épreuve du retrait de toute inspiration. Par miracle, après huit ans de cette très longue attente, soutenue courageusement, en quelques jours, lui arrivent la fin des Elégies ainsi que la totalité des Sonnets à Orphée, « dans une explosion de passion si violente qu’elle faillit me détruire, en même temps qu’une telle délicatesse, une telle convenance dans le geste que pas un seul vers, né antérieurement, n’eut de mal à trouver la place où s’intégrer comme un degré naturel, une voix entre les voix ».
Ce qui peut ouvrir chemin aujourd’hui, pour tous les hommes, ce ne peut être une carte routière où tout est tracé d’avance. Peut-être que le sens de la modernité poétique, dans sa plus haute tenue, nous apprend qu’il n’est d’existence authentique qu’en tant qu’elle s’invente.
Cézanne est un peu le Moïse de notre temps. Placé devant la montagne Sainte Victoire, il ne sait plus ce qu’est une montagne. Même une pomme, une simple pomme, il ne sait plus ce que c’est. Nous, en revanche, avec nos certitudes, nous ne la regardons même plus. Lui, en ne sachant plus rien, peut redécouvrir à neuf un rapport possible à une pomme, à une chose, à un être, au monde. En prenant ce risque, il est prêt à tout découvrir d’une manière si vivante que son œuvre reste, aujourd’hui encore, plus d’un siècle après, entièrement bouleversante.
Chercher à toujours se sécuriser, finit par nous enfermer dans une sorte de cocon. On peut s’y sentir protégé (c’est un peu douillet) mais il n’y a plus aucun espace ni aucun souffle qui y entre. Cela finit par sentir le renfermé. Tout est terne et plat.
Comment respirer à nouveau ?
 Nous le permettre est le rôle de l’art – et de la poésie qui en est la vérité. Marina Tsvetaïeva disait de la poésie qu’elle est « le premier millimètre d’air au-dessus de la terre ». En effet, avec la poésie, le discours cesse, le souci de sécurité qui nous conduit à ne rester qu’auprès du déjà connu s’estompe. C’est cela le risque : maintenir ouverte la possibilité qu’arrive quelque chose que je ne sais pas déjà. Telle est la seule possibilité de rester vivant !
Nous le permettre est le rôle de l’art – et de la poésie qui en est la vérité. Marina Tsvetaïeva disait de la poésie qu’elle est « le premier millimètre d’air au-dessus de la terre ». En effet, avec la poésie, le discours cesse, le souci de sécurité qui nous conduit à ne rester qu’auprès du déjà connu s’estompe. C’est cela le risque : maintenir ouverte la possibilité qu’arrive quelque chose que je ne sais pas déjà. Telle est la seule possibilité de rester vivant !
2. Les auteurs que vous évoquez ont eu des destins étonnants, on pense ici à Nietzsche, Rilke ou même Cézanne, et souvent des destins très douloureux, voire tragiques. En quoi leurs exemples peuvent-ils nous aider à trouver un chemin, au vu du caractère exceptionnel de leur destin ?
Ce qui compte est de risquer la liberté, et donc de vivre dans un monde sans repères. Il faut accepter la catastrophe que cela implique — et que l’on peut nommer, en suivant la parole de Nietzsche, la « mort de Dieu ». Cette « mort de Dieu » n’est pas l’impossibilité d’avoir un rapport à Dieu, mais la mort du Dieu compris comme le garant de l’organisation du réel et de la société des hommes. Comme le dit Rilke : « Nos traditions ont cessé d’être conductrices, branches mortes que n’alimente plus l’énergie des racines. »
L’une des manières les plus claires de faire comprendre ce phénomène est de regarder la peinture. L’espace de la peinture classique est organisé par la perspective qui nous présente un monde entièrement structuré. Tout y converge vers le point de fuite — centre indiscutable et paradoxal du tableau —, visage du Dieu inconnaissable qui soutient l’entièreté du réel.
En revanche dans le monde moderne, qui s’ouvre en peinture avec Cézanne, le centre est partout. On le voit de façon évidente chez Kandinsky ou Matisse, et ce jusqu’à Pollock et Barnett Newman. Le tableau au lieu d’être centré se déploie de manière centrifuge. On pourrait y voir à l’œuvre la plus haute vérité de l’aspiration démocratique. C’est le nouveau visage du monde. D’un coup, les repères stables disparaissent, puisque chaque point où nous sommes est un centre possible. La norme n’est plus absolue. Elle doit être questionnée à neuf.
Se plaindre de cette situation inconfortable est l’activité de nombre des intellectuels contemporains. Ils décrivent comment tout fout le camp et comment il nous faudrait retrouver des repères, une morale, des fondements, un rapport à la loi. Certains, à l’inverse, prennent le contre-pied de cette attitude, arguant qu’après tout, la loi est archaïque et arbitraire et qu’il nous faut la dépasser… Ces deux voies ne sont pas en rapport à la vérité qu’il y a à penser et que nous éprouvons. Il existe, dans le monde moderne, un nouveau rapport à la loi et à l’ordre. Non pas qu’il n’y ait plus aucun point de repères, mais ils ne sont plus stables ou fixes. Chaque point dans le tableau, chaque citoyen dans la démocratie, a à trouver sa propre règle. Chaque homme, à l’âge de la mort de Dieu, doit trouver son propre chemin. Aucune religion ne s’impose plus. C’est certes effrayant, mais tout l’enjeu de ce livre est de montrer en quoi c’est aussi une chance extraordinaire, qu’il est possible de vivre désormais sans point de repères et sans absolu — en reconnaissant qu’il ne peut plus y avoir de réponse toute faite. C’est ce que chacun éprouve lorsqu’il aime quelqu’un : il doit trouver une manière dont l’amour peut se donner dans la relation telle qu’elle se vit. Il est absurde et vain d’essayer de reproduire les schémas déjà connus, de vouloir accomplir un projet déjà déterminé. La plupart des êtres humains restreignent et éteignent leur vie parce qu’ils oublient complètement la liberté. Ils sont déconnectés de leur propre expérience, ils ne l’habitent pas. Ils vivent de la peur.
Ce déficit d’intériorité, cette incapacité d’habiter sa propre expérience implique que tous les points de repère sont adoptés trop rapidement, sans qu’ils soient pensés et éprouvés. Cela aboutit à un résultat bien pire que lorsque les points de repère étaient imposés de manière dogmatique par une Eglise ou les pouvoirs en place. C’est l’attitude du zapping constant, de la superficialité, du narcissisme aveuglé qui ne conduisent qu’à vivre selon les poncifs fluctuants et fabriqués par l’industrie du divertissement et de la publicité mondiale. Un règne de l’indifférenciation pour que persiste l’uniformité de l’opinion. C’est tout le problème de ce que Pavese appelle « le métier d’homme ». Comment arriver à faire notre métier d’homme et retrouver une voix propre ?
Une fois que l’on commence à entendre que tel est l’essentiel, devient évident que nous n’avons pas à prendre Nietzsche ou qui que ce soit pour modèle. Nous ne devons pas vivre comme lui, mais par ce qu’il nous montre, essayons de trouver un chemin au plus près de la liberté.
L’important est de voir comment sa parole nous met en mouvement et nous invite à mieux comprendre par où la vie s’ouvre à nous, et par où elle ne s’ouvre pas.
Il n’y a pas de modèle parce que la vie de chacun est absolument unique. L’ambition du livre est d’aider chacun à s’interroger sur les étapes, sur les voies qui peuvent faire chemin pour lui. C’est ce qu’il nous faut réussir à entendre. Par exemple, que veut dire travailler ? Quel est notre rapport à l’argent ? Qu’est-ce que faire l’amour ? — de telle manière que s’y risque notre liberté et que travail, sexe et argent ne soient pas une forme supplémentaire d’aliénation.
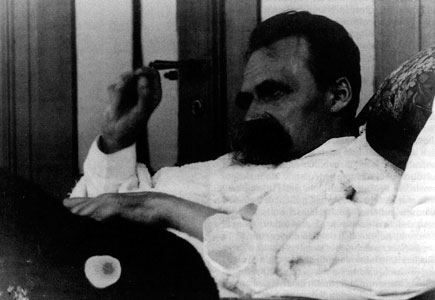 3. La place centrale de l’ordinaire est très étonnante dans le chemin que vous présentez, et cette nécessité d’un retour à un ancrage dans la quotidienneté surprend, pourquoi y insister autant ?
3. La place centrale de l’ordinaire est très étonnante dans le chemin que vous présentez, et cette nécessité d’un retour à un ancrage dans la quotidienneté surprend, pourquoi y insister autant ?
Le mot de « spiritualité » nous induit souvent en erreur parce qu’il tend à nous laisser croire qu’il s’agit de nous « élever » hors du monde matériel. La réponse spirituelle, en ce qu’elle prétend nous élever hors de l’immédiateté la plus concrète, nous déplace de notre véritable tâche.
Ceux qui souscrivent au discours spirituel se retrouvent du coup piégés dans une forme de rêverie. Et ceux qui s’y opposent justifient leur engagement dans le fait que ce discours ne réponde à rien de réel. Il y a là un cercle vicieux propre à notre temps, qui fait que ceux qui critiquent la spiritualité sont fondés à le faire car elle est trop éthérée, et ceux qui, à l’opposé, critiquent le monde matérialiste sont d’autant plus autorisés à rêver que le matérialisme est violent.
La racine de la confusion vient de l’association faite entre la spiritualité et la transcendance. Cette compréhension est une catastrophe. La lecture de Nietzsche est ici d’autant plus nécessaire car elle nous désintoxique de cette entente courante de la « spiritualité » qui est un piège.
Au fond, l’Occident s’est tout entier crispé et cristallisé en coupant le monde en deux, en reniant l’ici-bas pour un au-delà. Telle est la critique que fait Nietzsche d’un certain visage du christianisme contre lequel il s’élève. Or, Rilke, qui n’a pourtant pas lu Nietzsche, fait le même constat. Il décrit la manière dont les religions nous séparent de l’ici-bas et, tout particulièrement, au moyen d’une certaine répression de la sexualité. Les religions opposent à tort la sensibilité, la sensualité, à une intelligence qui lui serait supérieure. Ces ordres distincts sont devenus pour la plupart de nos contemporains des évidences : il y a le sensible d’un côté, l’intelligible de l’autre ; le corps et l’esprit ; les sens et l’intelligence ; l’émotion et la raison. Cette partition nous déchire et nous trompe sur notre être propre.
C’est la conviction cruciale du bouddhisme et la raison de son importance pour l’Occident. C’est pour cela que je me suis tourné très tôt vers lui. L’image la plus connue du Bouddha et qui symbolise son éveil, le représente en train de « prendre la terre à témoin ». C’est un moment important dans l’histoire de l’humanité. Il y a deux mille cinq cent ans, un homme a ouvert une nouvelle voie spirituelle, non pas en montrant un nouveau dieu, mais en touchant la terre. Ce geste a été médité par les diverses traditions bouddhiques. Dans le Zen par exemple, elle se révèle par cette fameuse manière qu’ont les maîtres de ne jamais répondre aux questions. Un disciple demande ainsi : « Qu’est-ce que le Zen ? Maître je vous prie de m’enseigner la Voie » et le maître lui répond : « Va laver ton bol. » Il ne répond pas à la question, mais déplace l’esprit du disciple pour le ramener à quelque chose de très concret.
Or, cette attitude cruciale, ce refus de la spiritualité éthérée, rejoint l’engagement de Nietzsche, de Rilke ou de Cézanne. Le mouvement que nous avons à faire n’est pas de nous élever mais de changer notre regard de telle manière que nous laissions la réalité apparaître et que puisse s’ouvrir ainsi un inconnu, ou un « invisible » pour reprendre le mot de Rilke. Lorsque vous mangez un fruit par exemple, la sensation du fruit n’est pas nécessairement un plaisir charnel ou animal. Vous pouvez aussi entrer dans l’infini de la sensation, dans son invisible. C’est ce que nous apprend la poésie. Il y a autant de ciel dans un fruit que dans un mythe. S’il y a un chemin pour l’homme, il ne consiste pas à mépriser son quotidien, à surmonter son corps, à laisser tomber le souffle, mais à les habiter de manière authentique et vive. Le Ciel et la Terre ne s’opposent pas, mais sont en dialogue constant.
Le bouddhisme n’est donc pas qu’une tradition orientale qui nous serait étrangère. Depuis des auteurs comme Rilke et Nietzsche, son lit est fait en Occident. Le bouddhisme n’est pas terrorisé devant l’absence de points de repère, il y voit même la seule manière d’être authentique. Selon lui, la catastrophe découle tout au contraire du besoin de points de repère auxquels nous nous cramponnons, et qui nous empêchent d’être en rapport avec l’ampleur du réel. Pour lui les idéologies sont des pièges mortifères. A travers ces notions très mal traduites d’impermanence ou d’interdépendance, le bouddhisme pointe la manière dont on veut solidifier la réalité – et qui conduit nécessairement à la souffrance. Accepter d’être sans points de repère est la seule possibilité de se détendre, de pouvoir sourire et d’avoir enfin un rapport vivant avec le monde.
L’Occident s’est rendu compte qu’il y avait un problème et Nietzsche, mais aussi Kafka, Rimbaud, Proust et tant d’autres nous ont appris à le découvrir. Le bouddhisme n’a de sens que pour autant qu’il soit un médicament contre ce poison que nous avalons chaque jour.
 4. Vous insistez sur la nécessité de se confronter au négatif, de ne pas éviter l’angoisse et la confusion. Mais alors quels sont les obstacles majeurs à l’établissement d’un authentique chemin ?
4. Vous insistez sur la nécessité de se confronter au négatif, de ne pas éviter l’angoisse et la confusion. Mais alors quels sont les obstacles majeurs à l’établissement d’un authentique chemin ?
Au niveau le plus simple, si vous pensez qu’avoir des émotions est un obstacle, ou qu’être confus est un échec, alors il n’y a plus de chemin possible. Vous êtes toujours humilié par la vie qui devient un combat permanent.
En refusant de laisser la moindre possibilité à nos ombres d’apparaître, nous souffrons bien plus que si nous prenions le risque de les regarder et de les considérer. N’ayons pas peur de notre vulnérabilité. Pour ma part, si on me demandait ce qui, pour un être humain, fait qu’un chemin authentique s’ouvre à lui, je dirais que c’est d’abord d’avoir le courage d’affronter ses propres ombres, ses propres fantômes, ses propres angoisses.
Là est le cœur de la plus haute vérité spirituelle. Il ne s’agit pas de rêver sur la vie après la mort ou sur le mystère de l’énergie cosmique. Beaucoup de gens passent à côté de leur propre grandeur ou de leur propre chance parce qu’ils ne veulent pas se relier à ce qui est sombre en eux – or, seuls nos ombres nous éclairent. C’est très simple à comprendre : lorsqu’on aime quelqu’un profondément, ses défauts ou ses qualités deviennent en réalité la même chose, et forment un même visage. Ce sont juste deux manières de le regarder. L’un ne peut aller sans l’autre. Si on enlevait les défauts, les petites maladresses, et surtout la faille propre à chacun, on lui enlèverait par là même son être propre. Tout le monde a fait au moins une fois cette expérience, où est dépassée l’opposition entre ombre et lumière, qualités et défauts. On voit les choses plus amplement. Tel est l’amour. L’amour voit par-delà les oppositions convenues. Il sait de manière ample.
Si le mot « sérénité » a un sens, ce n’est pas celui d’une mise à l’abris définitive hors de toute confusion, mais de parvenir à la regarder de telle manière qu’il devient possible de travailler avec elle.
Rien n’est plus terrible que ces gens qui jouent à être des sages, à être lisses et rassurants. Ils font toujours semblant. Ils sont très dangereux.
5. Vous insistez dans votre livre sur le sens des crises qui peuvent secouer nos existences et sur la manière dont elles peuvent être salutaires. Vous évoquer notamment celles que vous avez traversées et qui vous ont conduit à prendre des décisions qui n’allaient pas de soi. Mais qu’est-ce qu’une crise ?
Il y a un moment dans sa vie où on a à traverser des crises. Quelque chose vient à vous et vous dit : « si tu continues dans cette direction tu vas te renier complètement. D’accord, cela semble plus sûr, mais tu vas te renier. »
On continue par devoir, par fidélité, mais aussi par une secrète lâcheté, tout en sachant bien, au fond de soi, que l’on est en train de se renier. La question centrale consiste à se demander non pas si je suis fidèle mais : à quoi le suis-je ? Qu’est-ce qui nous semble le plus important ? Cette question provoque souvent une crise et chaque être humain dans sa vie y est un jour ou l’autre confronté.
Ce type de moments cruciaux est survenu, pour ma part, lorsque je me suis rendu compte que mon engagement dans le bouddhisme commençait à devenir une nouvelle forme de discours, une façon de me mettre à l’abri. Il y avait le petit groupe des bouddhistes et puis les autres… Mais j’en parle en détail dans le livre pour ne pas avoir à y revenir ici.
Dison simplement que d’un seul coup, cela ne sonnait plus juste. Or ce qui m’a sauvé de cette impasse, c’est la poésie. Elle m’est venue en aide car c’est la seule parole qui ne promet aucun salut. L’absence de promesse est la seule chose qui peut nous sauver parce qu’elle nous fait entrer dans l’immensité du réel. Je donne cet exemple dans mon livre, lorsque, rentré chez moi après un enseignement donné par un maître tibétain, j’ai écouté une sonate de Schubert et en ait été ému jusqu’aux larmes. Il y avait quelque chose de beaucoup plus juste que les trois heures passées à écouter un discours connu d’avance, qui ne se risquait à rien — mais que l’on considère important parce qu’il est religieux, parce qu’il est donné par quelqu’un de reconnu, parce qu’on est alors sous l’emprise des conventions.
La crise que j’ai traversée et que je décris dans le livre m’a été, même si je ne m’en suis évidemment rendu compte qu’après-coup, salutaire. Mais alors, ce fut un déchirement intense. J’ai du beaucoup abandonner.
6. Pourquoi la poésie est-elle pour vous ce qui ouvre un chemin ?
L’écriture du livre fut une aventure et j’espère qu’elle en sera une aussi pour le lecteur. Au lieu d’établir un kit qu’on troque pour un autre aussitôt achevé sa lecture, j’ai voulu rendre plus poignant le sens du chemin et ouvrir les portes là où l’on avait oublié qu’il en existait. Je ne suis pas un gourou. C’est à chacun de réinventer sa vie. C’est là, je crois, la grandeur de la modernité que nous n’avons pas su écouter. L’histoire tragique et abominable du XXe siècle témoigne de ce paradoxe : la boucherie de la Première Guerre Mondiale fut le meurtre de la maison des Atrides, entraînant à sa suite le communisme-stalinisme, la Shoah, Hiroshima. Dans cette impossibilité de soutenir le mouvement ouvert par la modernité, quelque chose du destin de l’Occident s’est joué pour le pire. C’est comme si nous n’avions pas pu être à l’écoute de ce qu’on dit les poètes. L’écrasement de la poésie participe du même mouvement que ces catastrophes dont j’ai parlé. Les poètes sont les seuls porteurs d’une parole qui libère. Ce ne sont pas les religieux mais les poètes qui sauvent, parce qu’ils ont fait l’expérience du péril ouvert, et que personne d’autre qu’eux n’est prêt à le faire. Très singulière époque en ce sens !
Il y a donc un enjeu politique à cet ouvrage, si le mot peu encore avoir un sens. J’évoque dans le livre la mort de tant des miens dans les camps de concentration et comment ma vocation est née là. Nous devons ré-envisager un peu mieux que nous ne l’avons fait la barbarie ou la catastrophe qui a signé notre temps.
Les discours qui tachent d’établir une nouvelle éthique avec des comités pour ce faire, des experts qui ne produisent que davantage de discours, ne répondent pas à ce qui s’est passé et à ce que nous devons repenser. Tout le monde voudrait s’en tirer à trop bon compte. La Shoah n’est pas un accident malencontreux. Elle fait chavirer le destin de l’Occident et nous impose de le repenser.
L’ensemble des propos que je tiens s’enracine dans cet impossible qui me marque dans ma chair même, cet impossible dont Auschwitz est le nom et qui fut la négation radicale de l’être même de l’humain. Par cette fabrication industrielle de cadavres, tout s’effondre. Mais nous ne voulons pas voir ce qui s’est effondré. Le nazisme a été battu par les armes mais son idéologie est loin d’avoir disparue. On ne peut pas se contenter de croire ou de dire que les Nazis sont des monstres et passer à autre chose. L’histoire est bien plus compliquée que cela. Le refus d’un Jankélévitch de parler aux allemands après la Shoah est bien trop court et bien trop commode. Nous n’en sommes pas quittes. Chacun de nous en est marqué.
Quant à l’autre « cliché » qu’est le « devoir de mémoire » — il est très en-dessous de ce qu’il nous faudrait réussir à penser, de ce que nous avons à soutenir. Nous avons quelque chose à faire de bien plus décisif que simplement garder mémoire de la Shoah. Nous avons à en soutenir l’effroi, à penser la manière dont l’être de l’être humain en a été atteint. Je refuse d’être consolé. Cela paraît inactuel, puisque ce que tout le monde attend de nos jours sont des consolations. Je ne veux pas être consolé de la barbarie du XXe siècle. Tel est, en un sens, la grande question de ce livre : comment, malgré le refus de toute consolation — et donc de toute religion — un salut est-il possible ? Où trouver une possibilité de dire « oui » à l’existence ?
Ma conviction est que la poésie est vraiment celle qui console, parce qu’elle n’apporte justement aucune consolation. Elle nomme en vérité, parce qu’elle ne fait pas de discours. Elle ouvre un chemin sans promesse. Une parole spirituelle ne m’intéresse qu’à condition d’être d’abord prête à risquer la liberté, à vivre dans un monde sans repères, à l’écoute de la poésie. Et cette tâche est devant nous…
Fabrice Midal
Fabrice Midal est docteur en Philosophie de l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne. Sa thèse obtenue en 1999, porte sur le sens du sacré dans les 
L’essentiel de sa formation il la reçoit non à l’Université, mais en classe de Khâgne au Lycée Pasteur à Neuilly de 1994 à 2001. Il se rend tous les jours, pendant sept ans, comme auditeur libre, au cours de philosophie de François Fédier. Il évoque l’importance de cette rencontre dans Au service du sacré (Éditions du Grand Est, 2007) et dans Risquer la liberté.
Né en 1967, dans une famille juive ashkénaze, Fabrice Midal se tourne très tôt vers le bouddhisme et étudie auprès de nombreux maîtres de la tradition tibétaine : Khandro Rimpoche, Thrangu Rimpoche, Khenpo Tsultrim Gyatso, le Loppon Tenzin Namdak… Mais son engagement principal est marqué par la rencontre de l’enseignement et de l’œuvre de Chögyam Trungpa. Il y découvre un bouddhisme non-dogmatique qui est du côté de la poésie et de la liberté et invite à un engagement social, politique et artistique.
Fabrice Midal est parti interviewer un grand nombre de disciples et personnalités pour rédiger la biographie, traduite depuis en espagnol et en américain, de Chögyam Trungpa.
Il enseigne la méditation à partir de 1995, et est invité à diriger des séminaires dans toutes l’Europe.
En 2007, ne voyant plus comment transmettre la méditation, hors de tout esprit de chapelle, il fonde l’association Prajna & Philia pour se donner les moyens d’établir un bouddhisme d’Occident. Ce moment de crise est racontée dans Risquer la Liberté.
Fabrice Midal a écrit plusieurs ouvrages sur le bouddhisme, dont il est un spécialiste reconnu. Ses ouvrages portent aussi bien sur des questions précises comme l’histoire de l’école Kagyü (La Pratique de l’éveil, 1997) ou la place des dieux et des mythes au sein du bouddhisme (Mythes et Dieux tibétains, 2000). Il vient de rédiger une introduction vivante et nourrie à ce qu’est le bouddhisme (ABC du bouddhisme 2008).
Fabrice Midal a écrit aussi plusieurs ouvrages sur l’art, cherchant à rappeler l’importance poétique de la modernité (Petit traité de la modernité dans l’art, 2007 ; Jackson Pollock, ou l’invention de l’Amérique, 2008).
Risquer la liberté présente ces divers engagements en cherchant à montrer comment peut s’ouvrir un chemin à l’homme d’aujourd’hui.
Fabrice Midal a dirigé la revue Cratère (1989-1992) qui a publié des entretiens avec Pierre Emmanuel, Claude Minière, Claude Simon, Nathalie Sarraute, Pierre Soulages…
Plasticien, il a participé à de nombreuses expositions en France et à l’étranger.
Il enseigne la photographie à l’Université Paris VIII.
 Découvrez le livre Risquer la liberté
– Retrouvez l’intégralité de la préface de Risquer la liberté en cliquant ici. |




